Le 23 aout 1789 en France, l’assemblée constituante débat sur la déclaration des Droits de l’Homme. Les problèmes de la liberté religieuse s’invitent au débat et de peur que la question soit ajournée, le révolutionnaire Mirabeau déclare : « n’oubliez pas le massacre de la Saint-Barthélémy ! ». La liberté de religion sera finalement consacré dans l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme « nulle doit être inquiété de ces opinions même religieuse, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. » Mirabeau fait ici référence à un triste évènement dans l’histoire de France, confrontant les catholiques face aux protestants, le 24 aout 1572 à savoir : la Saint-Barthélémy.

À la fin du XVe siècle, les mentalités changent, avec le mouvement humanisme qui bat son plein ainsi que par la découverte de l’Amérique et la dénonciation des abus de l’Église.
Une invention majeure, l’imprimerie va être inventé en 1434, qui permettra la diffusion des idées. Dans ce contexte un moine allemand du nom de Luther, affichera sur son église 95 thèses en 1517, ou il critique les indulgences de l’Église. De ce fait, les indulgences est la rémission des péchés par une somme d’argent ou des dons.
Dans le Saint Empire germanique, cette pensée va se développer très vite en partant de la ville de Wittenberg et essentiellement dans le Nord tel que dans les pays scandinaves. Du fait des s’est événements, Luther est excommunié en 1521. Sur le front, Luther propose une foi plus sincère et plus authentique en demandant une « relecture de la Bible ». En France, la position du roi est plutôt celle de la conciliation. En 1534, se déroule « l’affaire des placards » où des affiches antipapiste sont placardé dans les rues de Paris. C’est un affront au roi catholique, considéré comme un « crime de lège majesté ». Le roi François Ier décide d’ordonner des arrestations ainsi que des exécutions a tous les « hérétiques ». Soit, la France vient de choisir son camp : celui du Pape.


Malgré les mesures prise par le gouvernement royal, le mouvement luthériens continue à se diffuser, notamment grâce à un théologien picard Jean Calvin. Il poursuit l’œuvre de Luther et l’enrichit davantage depuis Genève qui deviendra la place forte du « calvinisme ». Néanmoins, ces idées se diffusent principalement dans le sud de la France, chez les populations de lettrée.
C’est à partir de 1559 que les choses vont s’intensifier où va se provoquer deux évènements majeurs. Tout d’abord, les monarques européens (Espagne, Saint Empire Germanique et France), mettent fin à la guerre qui les opposait par le trait du Cateau-Cambrésis. Leur but est de régler les problèmes internes à la réforme.
Ensuite, le roi Henri II va mourir lors d’une joute. Ce qui provoquera une crise pour en France jusqu’à l’arrivée du nouveau roi François II, âgé de 15 ans. Étant donné que François II est trop jeune pour gouverner, ce sera donc Catherine de Médicis femme du roi défunt qui deviendra la régente du royaume de France. Ce qui provoquera une guerre avec les grands nobles siégeant au conseil du roi qui ouvriront une guerre de religion.
Va se créer deux factions, les catholiques et les protestants dans le but de pouvoir être celui qui sera le plus proche du roi afin d’influer sur la politique du royaume. Il y a donc lutte religieuse et lutte de pouvoir qui vont s’entremêler. Cependant, il ne faut pas oublier que c’est nobles sont tous issue de grande famille. Du côté protestants, nous allons avoir la maison de Bourbons-condé, mais aussi Coligny et Montgomery. Alors que du côté catholiques, nous allons avoir la maison de Guise ainsi que la maison de Montmorency. Néanmoins, le roi François II, meurt à l’âge de 17 ans, c’est alors son frère Charles IX qui lui succède, tout en laissant la régence à Catherine de Médicis.
En 1652, Catherine de Médicis, fait signer à Charles IX l’édit de Janvier afin d’apaiser les tensions existantes. De ce fait, ce traité ordonne de rendre les cultes volés la religion au catholique. Dans la plupart des cas, les protestants rendront les églises en les brulants. De plus, il autorise l’utilisation des cultes, mais à l’extérieur des villes. Néanmoins, dans la ville de Wassy, François de Guise membre du catholicisme, assiste à une célébration de culte protestant, ce qui va à l’encontre du traité de Janvier. Ce qui provoquera des émeutes et la mort d’une cinquantaine de protestants. Ce qui entamera les débuts des guerres de religion, au total, il y en aura 8.


La première guerre de religion débutera en 1562 jusqu’en 1563, avec la restriction des libertés de culte par la publication de l’édit d’Amboise. En 1567, des protestants massacreront des catholiques pendant l’émission des Michelade de Nîmes. Puis Condé décide d’enlever le roi Charles IX, ce qui provoquera la seconde guerre de religion de 1567 à 1568. Une trêve est signée en 1568, qui sera surnommé la paix de Longjumeau. Mais pas pour longtemps, puisque la même année à lieu la 3e guerre de religion jusqu’en 1570. Cette fois a l’avantage des catholiques et se finira par la paix de Saint germain limitant la liberté de culte, mais les protestants reçoivent 4 place de sureté : La Rochelle, Cognac, Montauban et La Charité. Tout cela reste très précaire et étrangement l’amiral Coligny, partisan du protestantisme devient conseiller du roi.
Afin de réconcilier les deux camps, Catherine de Médicis décide en 1572, de marier sa fille catholique, Marguerite de Valois, à un protestant Henri de Navarre, futur Henri IV. Grâce a ce mariage arrangé, le conseil du roi, Coligny, aimerait aider les protestants des Flandres, actuel Pays bas qui sont en révolte face au roi catholique, le roi d’Espagne Philippe II. L’objectif est d’arrêter que les nobles s’entretuent. Pour ce faire est organisé le 22 aout 1572, là l’intermédiaire de la reine ainsi que du Pape, les « noces vermeilles ». Lors de cet évènement, les grands chefs protestants décident de monter à Paris, dans une ville catholiques. De ce fait, ce qui va mettre le feu aux poudres, est une tentative d’assassinat sur le conseiller du roi, Coligny, par un tueur professionnel. Seul problème, personne ne sait de quel parti ce mercenaire provient.


De peur pour sa vie, le roi Charles IX décide de convoquer le conseil au Louvre et décidera d’ordonner l’exécution de tous les chefs protestants. Il dira « tuer les tous pour qu’il n’y en reste pas un pour me le reprocher ». À la suite d’une fuite de l’information, les Parisiens décident de prendre les armes afin e tuer tous les protestants présents dans la ville.
La situation devient vite incontrôlable et échappe au pouvoir royal. De fait, tous protestants, qu’il soit des hommes, des femmes ou encore des enfants, tous sont tués d’une incroyable violence. En effet, certain seront transpercer, tandis que d’autres seront, découper, émasculer, pendu ou encore jeter des fenêtres ainsi que dans la Seine.
Selon certaines sources, il y aurait eu entre 2000 et 3000 à Paris et près de 10 000 dans toutes la France. Jules Michelet dira « ce n’est pas une journée mai une saison ». La 4e guerre de religion s’ouvre et les tensions ne s’apaiseront qu’en 1598 par l’édit de Nantes.

Bibliographie
- Dulaure Jacques-Antoine. Les massacres de la Saint-Barthélémy [Texte imprimé] : récit des évènements du 24 août 1572 extrait de l’Histoire physique, civile et morale de Paris. les Perséides, 2004.
- Erlanger Philippe. Le massacre de la Saint-Barthélémy : 24 août 1572. Gallimard, 1960.
- Garrisson Janine. La Saint-Barthélemy. Ed. Complexe, 1987.
- Jouanna Arlette. La Saint-Barthélemy : les mystères d’un crime d’État (24 août 1572). Gallimard, 2017.
- Question d’Histoire, publié le 6 juil. 2016, « Qui est responsable du massacre de la St-Barthélemy ? [Questions d’Histoire #03] » ; [consulté le mardi 7 décembre 2021] URL: https://www.youtube.com/watch?v=J3-OobrDHfA&t=477s
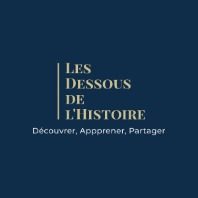

Laisser un commentaire