Le couronnement d’Ivan le terrible, le 16 janvier 1547, a été suivi de près par l’avènement de Sigismond II Auguste, dont le père est mort le 1er avril 1548. Si la Russie est agitée de soubresauts, du côté polonais, il faut attendre 1552 pour qu’un compromis provisoire soit conclu entre l’Église et les adeptes de la Réforme Le monde catholique se préoccupe aussi de l’expansion de l’islam et souhaiterait monter une coalition contre les Turcs. On envisage d’y associer Ivan le terrible, qui, justement, s’engage dans la conquête de Kazan et d’Astrakhan. À l’automne 1553, une trêve est conclue entre la Russie et la Pologne ; on la confirme pour six ans en janvier 1556. Dans l’intervalle, Ivan le terrible a noué ses premières relations officielles avec l’Angleterre

Avec la Suède, pourtant plus proche, la Russie a des relations assez distantes au cours de la première moitié du XVI e siècle. Ce pays connaît alors une mue importante avec l’avènement de Gustave Ier Vasa, artisan de l’indépendance et fondateur d’une nouvelle dynastie. D’origine assez humble, il réussit à libérer la Suède de la domination danoise. Élu roi en 1523, il gouverne d’une main de fer jusqu’à sa mort, le 19 septembre 1560, et impose la Réforme protestante dans ses États. Une ambassade suédoise vient à Moscou dès janvier 1534 confirmer la paix en vigueur avec la Russie et obtient sa prolongation pour soixante ans. Des échanges de routine ont encore lieu chaque année entre 1536 et 1539, puis les contacts cessent, mais sans hostilité particulière. Il contraint les Suédois à venir négocier et rejette catégoriquement tout changement de procédure. La paix est finalement signée, à Novgorod comme il se doit, en mars 1557 .Tout change brutalement en 1554. Soudain, les incidents de frontière se multiplient en Carélie, dans la zone de contact entre les deux pays. Gustave Vasa tente d’en profiter pour abolir l’ancien usage voulant que la partie suédoise négocie d’abord avec les lieutenants de Novgorod et non directement avec le tsar à Moscou. Les tentatives de délimitation à l’amiable échouent et, en septembre 1555, les Suédois font une incursion contre la forteresse d’Orechek, près des sources de la Néva et du lac Ladoga. Les Russes contre-attaquent en décembre, puis accentuent leur riposte et menacent Vyborg. Ivan le terrible rejette toute la responsabilité du sang chrétien répandu sur les Suédois et se pose en « souverain équitable. C’est précisément à ce moment qu’Ivan le terrible hausse considérablement le ton vis-à-vis des Livoniens.
La Livonie (Livland), constituée entre la toute fin du XII e siècle et le début du XIII e siècle, a d’abord été une terre de mission dans l’un des derniers réduits du paganisme en Europe. Au début du XVI e siècle, le pouvoir y est partagé entre quatre seigneuries diocésaines, des villes affiliées à la Hanse et la branche livonienne des Chevaliers teutoniques. Le premier prélat est l’archevêque de Riga, après lequel viennent les évêques de Dorpat (actuellement Tartu, en Estonie), d’Ösel-Wiek, et de Courlande. Riga, Dorpat et Reval (Tallinn, Estonie) sont les trois principaux comptoirs locaux de la Hanse. Elles ont toujours des relations étroites avec Lübeck, centre de cette confédération marchande, mais jouissent d’une certaine autonomie et pèsent d’un poids important dans les relations avec la Russie. Narva garde des liens avec Reval, bien qu’elle soit sous la tutelle de l’Ordre.
Le maître de l’Ordre de Livonie (Landmeister) dirige la confédération militaire, ses prieurés et ses chevaliers. Les États de Livonie se réunissent régulièrement lors de diètes pour débattre de leurs intérêts communs

La Livonie conserve des liens historiques avec la papauté et l’Empire romain germanique, qui se considèrent, à des degrés divers, comme ses protecteurs naturels. Mais elle a aussi des échanges constants avec ses voisins immédiats de la chrétienté latine : la Pologne-Lituanie, le duché de Prusse, le Danemark et la Suède. La Réforme protestante bouleverse les structures politiques livoniennes. L’Ordre et les seigneuries ecclésiastiques commencent à se désagréger. Les questions confessionnelles sont très importantes dans l’évolution de la situation, mais la parenté joue aussi un rôle crucial. Par exemple, le margrave Wilhelm de Brandebourg est plutôt un partisan de la Réforme, ce qui ne l’empêche pas de devenir coadjuteur de l’archevêque de Riga en 1530, puis de lui succéder en 1539. Il doit sa position à son illustre famille. Son frère Albert n’est autre que l’ex-grand-maître de l’Ordre teutonique, devenu duc de Prusse en 1525. Par son grand-père, Casimir IV, il est apparenté à la maison royale de Pologne.
Les relations avec le monde russe sont très anciennes. Dorpat a été fondée, en 1030, par Yaroslav le Sage, un ancêtre d’Ivan le terrible, et les Russes lui donnent toujours son nom slave : Youriev. Entre le XIII e et le XV e siècle, en dépit de quelques crises, le commerce de la Livonie avec Novgorod et avec Pskov est florissant. Les choses commencent à changer après l’annexion de Novgorod et Pskov par le grand-prince de Moscou. Il n’hésite pas à utiliser l’arme de l’embargo commercial en fermant pendant vingt ans, de 1494 à 1514, l’hôtel des Allemands, qui est le comptoir de la Hanse à Novgorod. Le but est de désolidariser la Livonie de la Pologne-Lituanie et de dissocier la Hanse de la Livonie, de la Pologne-Lituanie et de la Suède. Dans les deux cas, les Russes souhaitent obtenir une promesse de neutralité de leur partenaire en échange de la liberté de commercer avec eux. La frontière entre la Livonie et la Russie se situe le long du fleuve Narva. En face de la cité homonyme de Narva, les Russes ont fondé, en 1492, Ivangorod, forteresse frontalière qui, jusqu’en 1557, a un rôle économique assez modeste. Comme avec les Suédois, les traités de commerce et de paix russo-livoniens, soumis à des révisions périodiques, sont toujours formellement conclus avec les Pskovitains et les Novgorodiens. Dans la réalité, les négociations se déroulent avec les représentants du souverain moscovite et le plus souvent à Moscou. Mais la ratification a lieu à Novgorod et c’est le lieutenant local qui signe.
Une paix de vingt ans, signée en 1531, arrive à échéance le 1er octobre 1551. Les Livoniens jouent un jeu, assez traditionnel semble-t-il, de libre interprétation des clauses du traité. Ils émettent à plusieurs reprises des réserves sur certaines de leurs obligations, mais pas forcément devant la partie russe, ou bien profitent de contradictions avec des traités plus anciens. De leur côté, les Russes ont dans leur arsenal un précédent remontant à 1505. À cette date, l’évêque de Dorpat se serait engagé à payer un tribut à Moscou. Des conflits plus précis éclatent. En septembre 1537, la Diète de Wolmar impose un embargo sur toutes les marchandises assimilables à de l’armement à destination de la Russie. En septembre 1548, l’Allemand Hans Schlitte, engagé par Ivan le terrible et muni d’un laissez-passer impérial, est empêché d’entrer en Russie avec les étrangers qu’il a recrutés pour le tsar. Malgré les protestations de Moscou, il demeure aux arrêts l’année suivante.
Quand les Livoniens vont négocier le renouvellement de la paix, au printemps 1550, les Russes exigent que tout embargo sur les hommes et les marchandises soit levé. Un sursis d’un an est malgré tout obtenu et l’on propose même de le prolonger jusqu’à la fin septembre 1557, pourvu que les Livoniens acceptent de régler les litiges pendants. Parmi ceux-ci, les Russes soulèvent soudain la question des églises orthodoxes laissées à l’abandon ou détruites en Livonie.En 1554, les Livoniens vont signer à Novgorod un traité qui sera le dernier avant un conflit dont ils ne soupçonnent pas l’importance. Ils souscrivent pratiquement à toutes les conditions d’Ivan le terrible, y compris à la demande d’acquitter le tribut de Dorpat, avec ses arriérés depuis presque cinquante ans. Ils obtiennent toutefois un délai de trois ans pour rassembler la somme. En réalité, ils maintiennent l’embargo sur les marchandises sensibles et font en sorte que l’empereur romain germanique interdise lui-même à ses sujets de se mettre au service du tsar. Ils savent que les Russes sont engagés dans une guerre difficile sur la Volga et pensent qu’ils ne sont pas près de leur demander des comptes. En outre, ils sont très occupés par leurs propres querelles.
L’archevêque de Riga mène en secret ses propres pourparlers avec les Polonais et ambitionne probablement de séculariser son diocèse, comme l’a fait son frère en Prusse. Le grand-maître de Livonie, Heinrich von Galen, est trop âgé pour empêcher ce projet. Mais son coadjuteur, Johann Wilhelm von Fürstenberg, décide de prendre les choses en main et emprisonne l’archevêque. Il est condamné par l’empereur et se voit déclarer la guerre par le roi de Pologne. La mort de Heinrich von Galen le fait grand-maître, le 20 mai 1557, mais il doit signer le traité de Pozvol (Pasvalys, en Lituanie actuelle) avec Sigismond-Auguste, le 14 septembre. Ce traité prévoit une alliance défensive et offensive entre la Livonie et la Pologne-Lituanie, ce qui est une violation de la neutralité livonienne à laquelle les Russes tiennent tant.
En réponse, Ivan le terrible durcit nettement sa politique commerciale. En représailles à l’embargo « sur les cuirasses », il interdit l’exportation de saindoux et de cire. Il se dit prêt à des concessions en octobre 1566, mais attend un geste de l’autre partie. Or en mars 1557, une nouvelle ambassade livonienne vient purement et simplement lui demander d’effacer la dette de Dorpat. Ivan menace de venir chercher lui-même le tribut et ordonne de fonder un port maritime russe en aval d’Ivangorod, sur l’estuaire de la Narva. Désormais, les marchands russes n’iront plus en Livonie et tout leur commerce sur la Baltique se fera par là. En décembre, l’ambassade de la dernière chance arrive à Moscou et marchande encore le montant du tribut. Elle met sur la table l’équivalent de 18 000 roubles, propose 1 000 florins hongrois par an à l’avenir et plaide qu’elle n’a pas mandat pour discuter du reste. Tout cela n’est que mensonge et atermoiements pour les Russes qui se sentent sûrs d’eux. Ivan le terrible donne à ses troupes l’ordre de passer à l’offensive .

Bibliographie
- De Madariaga, Isabel (2006), Ivan le Terrible , New Haven, Connecticut: Yale University Press, ISBN978-0-300-11973-2Wikipedia site:fr.tr2tr.wiki
- GONNEAU Pierre, « Chapitre VII. Victoires, bon gouvernement et premières crises (1552-1557) », dans : , Ivan le Terrible ou le métier de tyran. sous la direction de GONNEAU Pierre. Paris, Tallandier, « Biographie », 2014, p. 171-204. URL : https://www.cairn.info/–9791021002753-page-171.html
- Oakley, Steward (1993), Guerre et paix dans la Baltique, 1560–1790 , War in Context, Abingdon, New York: Routledge, ISBN0-415-02472-2Wikipedia site:fr.tr2tr.wiki
- Stevens, Carol Belkin (2007), Les guerres d’émergence de la Russie, 1460–1730 , Modern wars in perspective, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, ISBN978-0-582-21891-8Wikipedia site:fr.tr2tr.wiki
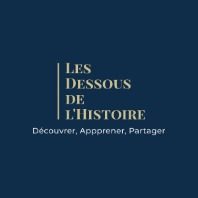

Laisser un commentaire